|
|
|

|
Après
un long voyage, trois semaines ou plus, dans leurs cages, malades du mal de
mer et sans hygiène, la chaleur humide de l'atmosphère, annonce enfin
l'arrivée des condamnés. Après avoir accosté, un médecin vient à bord et,
après s'être assuré qu'aucune maladie contagieuse était présente, le
gouverneur, accueille alors les nouveaux arrivants. |
|
Les
relégués reconnaissables à leurs chapeaux de feutre, débarquent les premiers,
pour être aussitôt convoyés généralement sur un chaland en direction du camp
de St Jean. Les condamnés aux travaux forcés les suivent, et convoyés vers le
camp dans les bâtiments où ils passeraient leur première nuit de déportation
on leur sert un repas composé de riz.
Le
lendemain, les "porte-clefs", condamnés à qui ont donnait la charge
d'ouvrir et fermer les cellules, déverrouillent les portes des anciens, puis,
les distributions des corvées effectuées, c'est au tour des nouveaux
arrivants d'être conduit à la visite médicale, puis au magasin d'habillement,
là, il leur est distribué leur tenue: Un chapeau de paille, une vareuse, et
le célèbre pantalon de toile rayé rouge. Chaque vêtement porte à l'encre
indélébile le numéro matricule, qui sera dorénavant la seule identité du
condamné.
|
|
Ensuite, les transportés subissent les formalités de mesures
anthropométriques, mensuration de la tête, des oreilles, des coudes, et le
relevé des empreintes digitales. (Les dix touches de piano.)
|
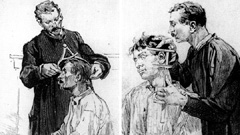
|
|
Habillés,
fichés, mesurés, et suivant leurs qualifications ou capacités, ils sont dirigés
vers les différents lieux de travail. Les plus instruits se voient, confiés des
emplois de bureau de l'administration pénitentiaire, et pour les autres sans
qualifications, ce sont les travaux dans les camps agricoles ou forestiers, ou,
pour les plus chanceux, les travaux d'utilité dans la ville de St Laurent,
entretien de la voirie, dockers, menuisiers |
|
D'autres
sont affectés à la garde et à l'entretien des animaux d'élevage comme au camp
des Hattes à l'embouchure du fleuve Maroni. Fermé en 1868, il est réouvert en
1910, pour accueillir les malades incurables, impotents et les convalescents.
|
|
Les
incorrigibles et les fortes têtes, sont envoyés à Charvein ou à Godebert.
Traités comme des animaux, nus, sans avoir droit à la parole, sous la surveillance
de gardiens sadiques, les condamnés sont astreint aux plus pénibles travaux.
Godebert et Charvein étaient les camps les plus terribles. Peu y ont survécu. |

|
|
Les
relégués (Les pieds de biches), quant à eux sont séparés des autres condamnés.
Ils s'agissaient d'individus qui avaient purgé la totalité de leur peine en
France, mais que la société avait décidé d'éliminer, en envoyant en Guyane pour
une peine supplémentaire les vagabonds et les récidivistes, si leur état de
santé le permettait. Classé en deux catégories, relégués collectifs et relégués
individuels.
Les
premiers, sont installés au camp de St jean, sous la coupe de l'administration
pénitentiaire, ils doivent en échange, une demi-journée de travail six jours
par semaine. Le reste du temps, ils sont libres, sans pour autant quitter St
Jean.
Les
relégués individuels, faveur admise par l'administration, au vu de leur
conduite antérieure, et pouvant justifier d'un moyen d'existence individuelle, sont
libres de circuler dans toute la Guyane à l'exclusion de Cayenne et des
communes limitrophes avec le Brésil.
Les
relégués peuvent après la sixième année de leur séjour en Guyane, obtenir
l'annulation de leur peine, en formulant une demande devant le tribunal. Cette
faveur, est accordée si le condamné peut justifier d'une bonne conduite, des
moyens d'existence, et de bons et loyaux services rendus à la colonie. Rare
sont les relégués qui réussissent à remplir ces conditions. En cas de refus, la
nouvelle demande ne pouvait être présentée que trois années plus tard.
|
| |
© 2001-2005 Guy Marchal
|